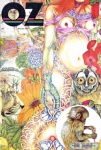La Physiologie du plaisir prend parfois des formes inattendues [en construction]
Dora fut une jeune et éphémère patiente de Freud qui l’érigea en cas clinique pour étayer sa théorie (Fragment d’une analyse d’hystérie, 1905)… Pour résumer rapidement la situation : Dora, prise dans un réseau complexe de relation entre ses parents et un autre couple (Mr et Mme K.), refuse de jouer le jeu. Bloquant la circulation et l’échange de la satisfaction amoureuse, et incarnant son désir (sa souffrance), Dora en vient à présenter, selon Freud, des symptômes de conversion hystérique.
Son père oblige Dora à consulter Freud, et ceci dans le but de faire taire les allégations de sa fille selon qui Mr K lui aurait, à plusieurs reprise, fait des avances…
C’est en lisant un extrait d’un livre de Patrick Mahony – Dora s’en va. Violence dans la psychanalyse – que je découvre un détail auquel je n’avais jamais pris garde : « Hans accusa Dora d’avoir imaginé la scène, la calomnia et joua son va-tout en disant qu’une fille qui lisait des livres érotiques ne pouvait prétendre au respect d’un homme. Dora se rendit compte que Peppina devait être à l’origine de cette médisance perfide, car c’était seulement avec elle qu’elle avait lu la Physiologie du plaisir de Paolo Mantegazza et discuté de sujets scabreux. »
D’emblée, je fus intrigué (mais néanmoins satisfait) d’entendre que la pauvre Dora avait de telle lecture : contrairement à ce qu’affirme injustement Mr K, quoi de plus naturel qu’une jeune fille affine secrètement son savoir érotique grâce à un livre. Le titre m’en parut extraordinaire… extraordinaire de simplicité et de modernité : la Physiologie du plaisir… je n’en avais jamais entendu parlé, et son auteur m’était totalement inconnu !
 Une rapide recherche sur internet me permit de découvrir les détails suivants :
Une rapide recherche sur internet me permit de découvrir les détails suivants :
Paolo Mantegazza (1831 – 1910), » médecin anthropologue, fondateur du Museum d’anthropologie et d’ethnographie de Florence, qui a écrit des ouvrages aussi sérieux que Physiologie du plaisir (1877), De la douleur (1888) ou De la haine (1889) ainsi que des comptes rendus de voyages aux Indes et en Laponie. »
En 1887, il écrit L’An 3000 – utopie dans lequel il décrit la relation (amoureuse) de Paolo et Maria dans un monde uni par le progrés qui, selon l’éditeur français du livre, prend » les allures inquiétantes d’une anti-utopie scientifique où sont éliminés sans remords les êtres inadaptés et où la pensée même est soumise au dirigisme impitoyable de l’Etat« . Malgré le titre du livre, l’histoire se déroule en l’an 2000, mais, en une intéressante mise en abîme, le jeune couple se divertit d’un livre ancien qui, évidemment intitulé l’An 3000, prédisait leur monde … L’Anno 3000
Le véritable choc fut pour moi de découvrir que Paolo Mantegazza avait expérimenté une substance dont Freud faisait l’apologie : la cocaïne !
Voici succintement une chronologie du produit qui révèle son emprise sur la génération de Freud :
En 1855, Friedrich Gardeke extrait l’alcaloïde de la feuille de coca. En 1856, naissance de Freud. En 1858, après avoir essayé le produit sur lui-même et en devenir un fervent partisant, Paolo Mantegazza écrit un livre Sur les vertues hygièniques et médicinales de la coca ! Ce n’est qu’en 1885 que Freud publie son fameux essaie sur la cocaïne (Über coca) !
Il est interressant de constater qu’à cette époque, la renommée de Paolo Mantegazza est sans conteste bien plus importante que celle de Freud. Mantegazza est publié dans plusieurs pays (La Physiologie est traduite en allemand et publié en 1872)… de plus, signe évident, il entretient une correspondance avec le maître incontesté de la pensée d’alors : Charles Darwin
Bien que la perspective de l’un soit très différente de celle de l’autre, j’entrevois néanmoins en Mantegazza une origine de la pensée freudienne qui finira par en occulter l’existence…
Dora / Rosa / Coca : surdétermination
« a) En reconstituant, en vue de sa publication, l’observation d’une de mes malades, je me demande quel prénom je vais lui donner. (…) un seul nom vient s’offrir, et aucun autre avec lui : le nom de Dora. Je cherche son déterminisme. Qui s’appelle donc Dora? La première idée qui me vient à l’esprit et que je pourrais être tenté de repousser comme invraisemblable est que c’est le nom de la bonne d’enfants de ma sœur. (…) Étonné, je demande qui s’appelle ainsi et j’apprends que celle que tout le monde appelait Dora s’appelait en réalité Rosa, nom auquel elle avait renoncé en entrant au service de ma sœur, parce que celle-ci s’appelait également Rosa. »
S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, 12 – Déterminisme, Croyance au hasard et superstition, Points de vue.
Au bord du lac, Dora apprit de la gouvernante des Zellenka que Hans, tout en faisant à la jeune femme une «cour assidue», s’était plainte à elle en ces termes: «Je ne peux rien tirer de ma femme.» Hans eut peu après recours à la même allusion sexuelle lorsque, en la courtisant à son tour, il fit une déclaration d’amour à Dora.
Monsieur K. et la vraie rivale de Dora, la jeune gouvernante, objet des faveurs de Monsieur K. et Dora. Ainsi s’expliquerait, mais d’une autre façon, cette phrase de Dora : » Il m’a traité comme une gouvernante ! »
Le vrai nom de « Dora » est Ida Bauer (1882-1945). (der bauer = le paysan / das bauer = la cage à oiseau)
Le véritable nom de M. K est M. Zellenka !!!
Zellen = cellules (bio) !! la cellule de prison = Gefängniszelle
Freud’s Dora, A Victorian Fable
Freud and Dora: repressing an oppressed identity
L’alphabet du désir inconscient avec les lettres du nom propre
Ida analysée par Freud pièce de théâtre par les auteurs anonymes !
« Fragment d’une analyse d’hystérie » (1905).
Télécharger sur Gallica :
Physiologie du plaisir
http://www.answers.com/topic/ida-bauer
Paul Verhaeghe, La lecture de Mantegazza par Dora, in Quarto, Février 1985, 18, pp. 23-26.
compte-rendu du livre de Patrick Mahony, Dora s’en va. Violence dans la psychanalyse